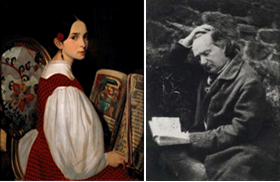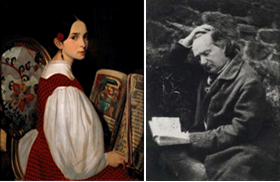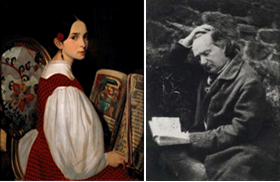L.A. d'après le devoir de votre camarade
[présentation] Romancier, poète, dramaturge, dessinateur, personnalité politique, chef de file du romantisme, Victor Hugo occupe une place importante dans l’histoire des lettres françaises au XIXe siècle. Victor Hugo est le chef de file du romantisme. C’est un géant de la littérature qui a embrassé le XIXe (1802-1885) et tous les genres littéraires. Il est déjà immensément connu lorsque, en 1843, il perd sa fille Léopoldine, qui se noie dans la Seine par accident quelques mois après son mariage. Cette mort affectera profondément le poète qui se tait plusieurs années avant de publier le recueil Les Contemplations en 1856, dans lequel il raconte des souvenirs et rend hommage à sa fille. Notre poème intitulé « Demain dès l’aube » évoque la figure de Léopoldine.
[lecture] je vous en propose une lecture
[problématiques possibles]
- Comment s'expriment les sentiments du poète ?
- Comment ce poème se transforme-t-il en un poème consolatoire ?
- Dans quelle mesure ce poème rend-il compte d’un amour toujours vivant ?
- En quoi la forme du poème contribue-t-elle à la force poétique ?
[plan] Nous étudierons…
[développement]
I. Le poème se présente comme une marche obstinée vers un rendez-vous sentimental :
(un poème lyrique)
Structure du poème ménage un dévoilement progressif de l’objet de la marche :
1ere strophe : le rendez-vous avec l’être aimé / 2ème strophe : la marche du poète solitaire, accablé / 3ème strophe : recueillement sur la tombe
1. Une marche
Verbes de mouvement qui expriment le départ (« je partirai », « j’irai» « j'arriverai » )
=> itinéraire
Temps du futur (=ai) mêlé au présent. Le poète projette son départ.
=> départ imaginé
2. Cette marche est obstinée (= une obsession)
Accumulation de CCT qui rejettent le GV au v2
=> obsession
Anaphore en début d’hémistiche du vers 3 (j’irai, j’irai)
=> une volonté obstinée
3. Un désir de retrouver la bien-aimée
L’impatience est notée par les expressions « je sais que tu m’attends » et
« je ne puis demeurer loin de toi » v.4
=> désir de retrouvailles
II. Evocation de la solitude du poète :
(Un poème élégiaque)
1. L’expression du « je » lyrique
Pronoms de la première personne : « je », « j’ », « mes » « moi »
=> présence du poète
2. La présence de la nature
Champ lexical « forêt », « montagne », « houx », « bruyère »
=> présence de la nature
3. Une nature niée
Négations nombreuses, sens visuel et auditif niés :
« in-connu », « je ne puis », « sans rien, sans rien », « ni l’or… ni les voiles
=> la nature n'est plus le refuge traditionnel
L’assonance en é du vers 4 montre l’accablement du poète, la monotonie.
=> tonalité élégiaque
III. Le pouvoir consolateur de la poésie
(la fonction du poème)
1. Un dialogue avec l’absente
présent d’énonciation + pronoms personnels de l'interlocution :
« vois-tu », « je sais que tu »
=> présence d'un interlocuteur, comme si le poète parlait à quelqu'un(e)
Une interpellation affectueuse :
Tutoiement « tu » v.2, « toi » v.4, « ta » v.11
=> apaisement du poète
2. Le pèlerinage :
Il s’agit d’un pèlerinage :
« la campagne », « la forêt », « la montagne»,
=> le poète accomplit un long trajet pour rejoindre l'être aimé dont on ne connaît pas encore l'identité...
La pointe du poème dévoile aux vers 11 et 12 l’identité de l’être aimé :
Le mot « tombe » se répète en écho sonore aux vers 9 et 11
=> Victor Hugo se rend sur la tombe de sa fille.
3. La commémoration / l’hommage :
La bruyère et le houx vert, symbole d’amour éternel (plante persistante, verte en hiver)
« Houx vert » : par l’homophonie, on a l’impression que le tombeau est "ouvert" pour des retrouvailles entre le père et sa fille.
=> idée d'éternité
Conclusion :
Pour conclure, notre poème élégiaque, triste, évoque le pèlerinage du poète sur la tombe de sa fille, et son recueillement. Le poème permet de faire revivre Léopoldine et de l’immortaliser. On reconnaît le pouvoir consolateur de la poésie, depuis le mythe d’Orphée.